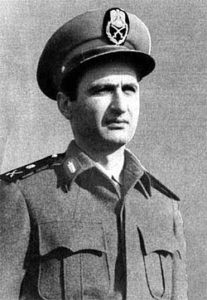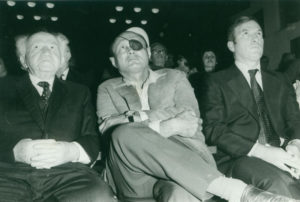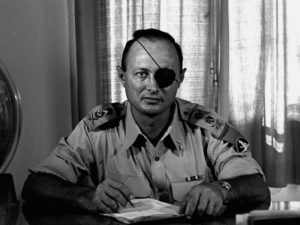Moshé Dayan est depuis son adolescence un chasseur amateur. Il aime chasser la perdrix et la colombe sauvage à partir desquelles il prépare des petits plats. La région sud et principalement la ceinture d’Adoulam située dans la partie septentrionale, constitue une bonne zone de chasse, et plus d’une fois il revient de ses tournées avec des colombes sauvages dans sa voiture. Son amour de la chasse va lui faire découvrir un nouvel univers.
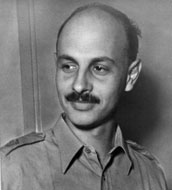
Au cours d’un chabat il part avec son fils Oudi chasser les pigeons dans les collines en marge des monts d’hebron. En chemin, ils longent Tell es-Safi, des ruines de Gath, une ville de l’époque biblique dont certains vestiges ont été mis à nu pas des pluies torrentielles. Sur le bord de pierres escarpé de la rivière, les inondations ont fait émerger des cruches entières comme à leur premier jour. Dayan n’a pas besoin de creuser longuement pour extraire quelques cruches du bord. Il pense qu’il s’agit de cruche de fella’h arabes qui habitent dans les environs, mais le chef d’État major, Ygael Yadin, archéologue professionnel, lui explique que ce sont des cruches de l’époque du royaume de Juda du IXème ou du VIIIème siècle avant Jésus-Christ.
Dayan retourne sur le site au cours des shabbats suivants. Cette fois il est équipé d’une pelle et met à jour une grande variété d’objets. Il est très ému. C’est une expérience fondamentale dans sa vie, et dans ses mémoires il la décrira ainsi :
 Ce fut m’a première rencontre intime avec l’ancien Israël. Cela me fit découvrir un monde nouveau, souterrain, une vie d’il y a 3.000 années. Un tableau exceptionnel, caché, secret, sous les routes, les maisons, les champs et les arbres, dans les localités de la Palestine et de Canaan, de Judée et de de Samarie, l’Israël âgé de milliers d’années.
Ce fut m’a première rencontre intime avec l’ancien Israël. Cela me fit découvrir un monde nouveau, souterrain, une vie d’il y a 3.000 années. Un tableau exceptionnel, caché, secret, sous les routes, les maisons, les champs et les arbres, dans les localités de la Palestine et de Canaan, de Judée et de de Samarie, l’Israël âgé de milliers d’années.
Cette rencontre avec le passé éveille en Dayan une obsession incontrôlée. Par la suite il consacrera de nombreuses heures à fouiller à la recherche d’objets antiques enfouis dans diverses collines d’Israël, ou à coller entre eux des débris d’objets dans le jardin de sa maison. Dayan expliquera cet engouement à la fin de sa vie :

Pour moi, qui étais né en Israël, l’amour de la patrie n’était pas un amour abstrait. Le lys du Sharon et le mont carmel étaient vraiment une fleur dégageant un parfum et une montagne dont mes pieds avaient parcouru les sentiers. Cependant, l’Israël que je voyais de mes yeux et je touchais de mes mains ne me suffisaient pas. J’étais avide de l’Israël antique, de l’Israël des noms et des versets. Face à moi, ce n’était pas simplement le Kishon qui traversait les champs de Nahalal, mais également le Kishon, l’antique rivière, qui avait entrainé l’armée de Sissera (ndlt : Livre des juges, chapitre 4). Si mes parents venus de la diaspora, avaient désiré transformer la terre d’Israël spirituelle décrite dans les livres en une patrie bien réelle, je voulais de mon côté apporter à ma patrie réelle une épaisseur spirituelle et historique, redonner l’âme du passé aux ruines et aux collines désolées, faire revivre l’Israël du temps des patriarches, des juges et des rois.
Ses fouilles ne sont pas vraiment légales et Dayan est la cible de nombreuses critiques. Mais il ne résiste pas à la tentation ou peut-être que ces critiques ne le touchent pas beaucoup. Cette avidité le possèdera toute sa vie et il accumulera une collection archéologique riche et rare, qui après sa mort, sera transmise au musée de Jérusalem.